
Contrairement à l’idée reçue d’une souveraineté absolue, l’isolationnisme est aujourd’hui la stratégie la plus coûteuse et la plus risquée pour la France.
- Agir seul face aux défis globaux (climat, pandémies, fiscalité des géants du numérique) est inefficace et mène à des pertes économiques et stratégiques.
- La coopération agit comme un « multiplicateur de puissance », permettant à la France d’imposer ses normes et d’accéder à des projets scientifiques ou industriels hors de sa portée.
Recommandation : Analyser chaque enjeu international non sous l’angle de l’idéologie, mais sous celui, bien plus réaliste, du coût de la non-coopération.
Dans l’arène des relations internationales, une vision semble dominer les esprits les plus « réalistes » : le monde est un échiquier où chaque nation avance ses pions dans un rapport de force permanent. Dans cette optique, la coopération internationale est souvent perçue avec méfiance, assimilée à une forme d’angélisme, voire à un abandon de souveraineté au profit d’intérêts qui ne sont pas les nôtres. L’idée de « s’allier » sonne comme une concession, un aveu de faiblesse face à un idéal d’indépendance nationale absolue.
Cette vision, bien que séduisante par sa simplicité, ignore une réalité fondamentale du XXIe siècle : l’interdépendance. Les plus grandes menaces comme les plus grandes opportunités – qu’il s’agisse de la régulation du numérique, des pandémies, du changement climatique ou de la recherche scientifique de pointe – transcendent les frontières. Mais si la véritable clé de la défense de nos intérêts n’était pas l’isolement, mais au contraire un égoïsme intelligent ? Si la coopération n’était pas un acte de générosité, mais l’outil le plus acéré du pragmatisme stratégique ?
Cet article propose de déconstruire ce mythe. À travers des exemples concrets et des résultats tangibles, nous allons démontrer que refuser la coopération représente un coût stratégique exorbitant. Nous verrons comment, loin d’être une faiblesse, la capacité à forger des alliances est un multiplicateur de puissance qui permet à la France de défendre et de promouvoir ses intérêts bien plus efficacement que si elle agissait seule. Il s’agit de redéfinir la souveraineté non comme la capacité de tout faire seul, mais comme celle de peser sur les règles du jeu collectif.
Pour ceux qui préfèrent une approche plus conceptuelle, la vidéo suivante explore les différentes manières de représenter le monde sur une carte. C’est une excellente métaphore de notre propos : il est temps de mettre à jour notre carte mentale des relations internationales pour y intégrer la dimension pragmatique et stratégique de la coopération.
Pour explorer cette thèse, cet article s’articule autour de plusieurs études de cas et d’analyses concrètes qui illustrent les bénéfices tangibles de la coopération et les dangers du repli sur soi. Chaque section met en lumière une facette différente de cet impératif stratégique.
Sommaire : La coopération, un levier de puissance pour les intérêts français
- Le dilemme du prisonnier : l’expérience qui prouve que l’égoïsme est souvent un très mauvais calcul en relations internationales
- Le jour où le monde s’est uni pour sauver la couche d’ozone : la preuve que la coopération internationale peut fonctionner
- L’aide au développement n’est pas de la charité : c’est un investissement pour notre sécurité collective
- CERN, ISS : quand les scientifiques du monde entier collaborent, ils peuvent accomplir des miracles
- Le poison du nationalisme : pourquoi le « chacun pour soi » est la stratégie la plus dangereuse pour l’avenir de la planète
- Le climat, les vaccins, internet : ces trésors qui n’appartiennent à personne et que nous devons gérer ensemble
- Un traité sur les pandémies : l’outil indispensable pour ne plus jamais revivre le chaos du Covid-19
- Au-delà des clivages : un consensus français pour un pragmatisme planétaire
Le dilemme du prisonnier : l’expérience qui prouve que l’égoïsme est souvent un très mauvais calcul en relations internationales
La théorie des jeux, et plus particulièrement le fameux « dilemme du prisonnier », offre une grille de lecture éclairante pour les relations internationales. Dans ce scénario, deux acteurs, en agissant chacun dans leur intérêt égoïste et immédiat, aboutissent à un résultat pire pour tous les deux que s’ils avaient coopéré. Cette abstraction trouve une application directe dans la fiscalité des géants du numérique. Pendant des années, chaque pays, y compris la France, a tenté de taxer seul les GAFA, créant une compétition fiscale où les multinationales sortaient toujours gagnantes en déplaçant leurs profits.
La taxe GAFA française, bien que symboliquement forte, illustre les limites de l’action unilatérale. Seule, elle ne devrait rapporter « que » 800 millions d’euros en 2024. Face à ce constat, la France a choisi de jouer un rôle moteur dans les négociations à l’OCDE. En acceptant de renoncer à sa taxe nationale au profit d’un cadre commun, elle a contribué à un accord historique. Ce choix n’est pas un renoncement, mais un calcul stratégique : un gain modeste et immédiat a été échangé contre un changement systémique bien plus profitable à long terme.
Cette coopération a permis d’aboutir à ce que le ministre de l’Économie de l’époque, Bruno Le Maire, a qualifié d’« accord fiscal international le plus important conclu depuis un siècle ». En sortant du dilemme du prisonnier, les 136 pays signataires ont collectivement augmenté leur pouvoir de négociation et mis fin à une course vers le bas. Pour la France, le bénéfice n’est pas seulement financier ; il est aussi normatif et politique, démontrant que la coopération est le seul moyen de réguler des acteurs économiques devenus plus puissants que de nombreux États.
Le jour où le monde s’est uni pour sauver la couche d’ozone : la preuve que la coopération internationale peut fonctionner
Face au scepticisme ambiant sur l’efficacité des grands accords multilatéraux, l’histoire du Protocole de Montréal est un puissant rappel à l’ordre. Dans les années 1980, la découverte d’un « trou » dans la couche d’ozone, causé par les gaz CFC, représentait une menace existentielle pour la vie sur Terre. La réponse ne fut pas une série d’actions nationales désordonnées, mais une mobilisation scientifique et diplomatique sans précédent. Le Protocole de Montréal, signé en 1987, est aujourd’hui considéré comme le plus grand succès environnemental de l’histoire.
L’efficacité de cette coopération est spectaculaire. Grâce à l’engagement quasi universel des nations, plus de 98% des substances appauvrissant la couche d’ozone ont été éliminées. Ce n’était pas de l’angélisme : les industriels, d’abord réticents, ont été poussés à innover, créant des substituts moins nocifs et ouvrant de nouveaux marchés. La coopération a ainsi transformé une contrainte environnementale en une opportunité économique et technologique.

Ce succès tangible démontre que lorsque la menace est clairement identifiée et que la volonté politique est présente, la coopération internationale peut produire des résultats concrets et mesurables. Comme le note l’Organisation météorologique mondiale, cette action collective porte ses fruits. Dans un de ses rapports, l’organisation estime que « la couche d’ozone retrouvera normalement son état de 1980 entre 2055 et 2065 ». Cet exemple prouve que le multilatéralisme, loin d’être une utopie, peut être un outil d’une efficacité redoutable pour gérer les biens communs de l’humanité et, par conséquent, assurer notre sécurité à long terme.
L’aide au développement n’est pas de la charité : c’est un investissement pour notre sécurité collective
Le terme « aide au développement » est souvent mal compris, connoté d’un sentiment de générosité unilatérale. Pour un esprit pragmatique, cela peut ressembler à un transfert de richesses sans retour sur investissement clair. Or, une analyse stratégique des programmes de coopération français révèle une tout autre réalité. Loin d’être de la simple charité, l’aide au développement est un instrument d’influence et de sécurité au service des intérêts nationaux.
En réalité, les objectifs sont profondément pragmatiques. Soutenir le développement de pays partenaires, c’est investir directement dans notre propre stabilité. Un État stable, avec une économie fonctionnelle et un système de santé résilient, est moins susceptible de devenir un foyer de terrorisme, une source de crises migratoires incontrôlées ou un point de départ pour de futures pandémies. Financer des projets d’agriculture durable au Sahel, par exemple, n’est pas qu’un geste humanitaire ; c’est une gestion préventive des flux migratoires liés à l’insécurité alimentaire.
De plus, cette coopération est un puissant levier économique et culturel. Les projets d’infrastructures financés par la France ouvrent des marchés pour nos entreprises, comme Vinci ou Veolia, qui exportent ainsi leur savoir-faire. Renforcer la francophonie à travers des programmes éducatifs, c’est maintenir et étendre notre « soft power » et notre influence dans le monde. Les objectifs stratégiques de la coopération française sont clairs :
- Créer des marchés pour les entreprises françaises via des projets d’infrastructures.
- Stabiliser les régions pour prévenir les crises migratoires et le terrorisme.
- Renforcer la francophonie et l’influence culturelle et politique de la France.
- Développer les systèmes de santé locaux, qui agissent comme une première ligne de défense sanitaire mondiale.
- Soutenir l’agriculture durable pour la gestion préventive des crises alimentaires et migratoires.
Vue sous cet angle, l’aide au développement n’est plus une dépense, mais un investissement stratégique à long terme. C’est l’un des outils les plus rentables pour défendre la sécurité et la prospérité de la France dans un monde interdépendant.
CERN, ISS : quand les scientifiques du monde entier collaborent, ils peuvent accomplir des miracles
Si la coopération est un levier de puissance en diplomatie et en économie, elle est une nécessité absolue dans le domaine de la « Big Science ». Les projets les plus ambitieux, qui repoussent les frontières de la connaissance humaine, ont atteint une échelle et un coût tels qu’aucune nation, même la plus riche, ne peut plus les assumer seule. La Station Spatiale Internationale (ISS) ou le Grand collisionneur de hadrons (LHC) au CERN en sont les exemples les plus emblématiques.
Pour une puissance moyenne comme la France, la coopération scientifique n’est pas un choix, c’est la seule voie possible pour rester dans la course mondiale. En mutualisant les coûts et les cerveaux, notre pays accède à des infrastructures de rang mondial et participe à des découvertes fondamentales qui façonnent le monde de demain. C’est un multiplicateur de puissance technologique. L’alternative – le repli national – signifierait un décrochage scientifique irrattrapable et une perte de souveraineté technologique à terme.
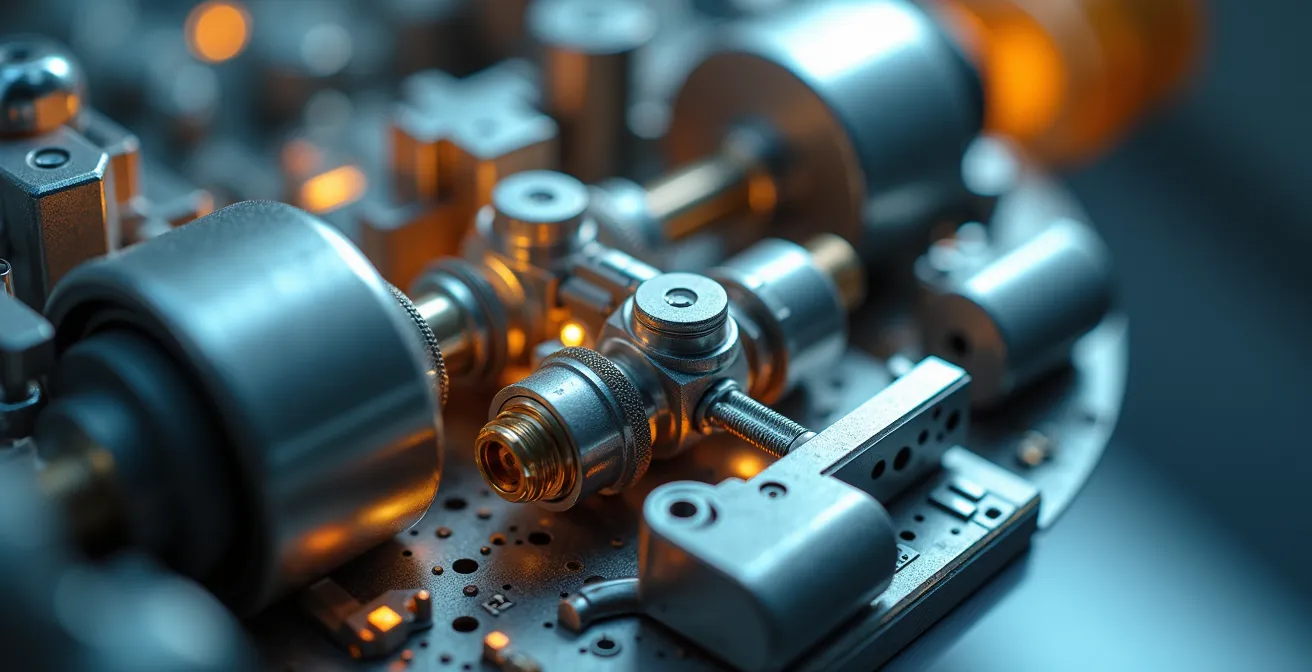
Comme le souligne une analyse sectorielle sur le bilan de la coopération scientifique internationale :
Sans coopération, la France n’aurait jamais eu les moyens de construire seule l’ISS ou le LHC. En mutualisant les coûts, elle accède à des infrastructures de rang mondial.
– Analyse sectorielle, Bilan de la coopération scientifique internationale
Au-delà de l’aspect financier, ces collaborations créent des réseaux d’excellence et attirent les meilleurs talents. Le CERN, par exemple, est un écosystème où naissent des innovations aux retombées inattendues – c’est là qu’est né le World Wide Web. Participer à ces projets, c’est donc non seulement partager les coûts, mais aussi récolter les fruits de l’innovation collective. L’isolationnisme scientifique est une illusion ; le véritable pragmatisme consiste à être un partenaire indispensable au sein des réseaux qui comptent.
Le poison du nationalisme : pourquoi le ‘chacun pour soi’ est la stratégie la plus dangereuse pour l’avenir de la planète
Le réflexe nationaliste, qui prône le « chacun pour soi » en temps de crise, est souvent présenté comme un acte de protection des intérêts nationaux. La pandémie de Covid-19 a offert une démonstration brutale et à grande échelle de l’inefficacité et du danger d’une telle approche. Les premières semaines de la crise ont été marquées par ce que l’on a appelé la « guerre des masques » : fermetures de frontières unilatérales, réquisitions, surenchères sur les tarmacs pour s’approprier les équipements de protection. Ce chaos a directement nui à la capacité de la France et de ses voisins à protéger leurs citoyens.
Le « chacun pour soi » a créé une compétition stérile qui a fait grimper les prix et retardé l’acheminement du matériel vital. Cette expérience a servi d’électrochoc. Très vite, les dirigeants européens ont compris que la seule issue passait par la coordination. La mise en place de commandes groupées de vaccins et, surtout, l’accord sur un plan de relance historique ont été la réponse coopérative à l’échec de l’isolationnisme initial. Ce plan, NextGenerationEU, a permis de mobiliser plus de 800 milliards d’euros pour soutenir les économies du continent, une somme qu’aucun pays n’aurait pu lever seul.
Cet épisode est une étude de cas parfaite : le réflexe souverainiste pur a d’abord aggravé la crise. Il a fallu un retour au pragmatisme et à la coopération pour en sortir. L’égoïsme à court terme s’est avéré être un très mauvais calcul. Il a non seulement eu un coût humain et économique direct, mais il a aussi affaibli la position de l’Europe dans son ensemble. La leçon est claire : face à une crise systémique, la solidarité n’est pas une question de morale, mais une condition de survie et d’efficacité.
Le climat, les vaccins, internet : ces trésors qui n’appartiennent à personne et que nous devons gérer ensemble
Certains des plus grands défis et des plus précieuses ressources du monde moderne sont, par nature, des « biens communs mondiaux ». Le climat, la stabilité de l’écosystème numérique ou la santé publique mondiale ne peuvent être gérés efficacement à l’échelle d’un seul pays. Tenter de le faire est non seulement voué à l’échec, mais c’est aussi renoncer à peser sur les règles qui régiront ces domaines cruciaux pour notre avenir. La coopération devient alors un levier pour imposer ses normes et défendre ses intérêts.
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est l’exemple le plus frappant de ce « multiplicateur de puissance » normatif. Seule, la France n’aurait jamais pu imposer ses standards de protection des données aux géants américains du numérique. En agissant de concert au sein de l’Union européenne, elle a participé à la création d’une norme qui s’est de fait imposée comme le standard mondial. Les entreprises du monde entier qui veulent accéder au marché européen doivent s’y conformer. C’est un acte de souveraineté par la coopération.
Comme le montre une analyse comparative de l’impact du RGPD, la différence de levier est immense :
| Aspect | Action nationale isolée | Coopération via l’UE (RGPD) |
|---|---|---|
| Portée | Limitée au territoire national | Application mondiale aux entreprises traitant des données européennes |
| Pouvoir de négociation | Faible face aux GAFA | Fort (amendes jusqu’à 4% du CA mondial) |
| Impact normatif | Négligeable | Devient le standard mondial de facto |
Le même principe s’applique au climat. Comme l’a noté la Direction générale du Trésor, « l’Accord de Paris crée un marché mondial pour les technologies vertes où les entreprises françaises sont des leaders ». La coopération climatique, loin d’être une simple contrainte, devient ainsi un levier pragmatique pour l’économie française en créant des opportunités pour ses champions industriels.
Un traité sur les pandémies : l’outil indispensable pour ne plus jamais revivre le chaos du Covid-19
Le coût de l’impréparation et de la non-coordination face à la pandémie de Covid-19 a été astronomique. Pour la France seule, les conséquences économiques furent brutales, avec une baisse du PIB de 8% en 2020 et une dette publique grimpant à 115% du PIB. Ce chiffre vertigineux ne représente que la partie visible de l’iceberg, sans compter les coûts humains et sociaux. Face à ce bilan, l’idée de négocier un traité international sur les pandémies n’est pas une lubie de bureaucrates, mais une démarche profondément pragmatique : c’est la construction d’une assurance collective contre un risque systémique.
L’objectif est simple : éviter de repayer ce prix exorbitant à l’avenir. Un tel traité vise à mettre en place des mécanismes qui ont cruellement manqué en 2020. Il s’agit de s’accorder à l’avance sur des protocoles pour ne plus avoir à improviser dans le chaos. Le « chacun pour soi » s’est révélé désastreux ; l’alternative est de se doter d’outils pour une réponse coordonnée, plus rapide et plus efficace. Cela ne signifie pas un abandon de souveraineté, mais l’exercice d’une souveraineté intelligente et prévoyante.
Le but est d’établir des règles claires pour l’avenir, car une autre pandémie surviendra inévitablement. Ne pas s’y préparer collectivement serait une faute stratégique impardonnable. L’enjeu est de transformer les leçons douloureuses de la crise en un système de défense robuste pour protéger nos citoyens et nos économies.
Plan d’action : les piliers d’un futur traité sur les pandémies
- Partage d’informations fiables et rapides entre États pour anticiper les menaces.
- Coordination des mesures aux frontières, notamment dans l’espace Schengen, pour éviter le chaos.
- Mise en place de mécanismes de répartition équitable des équipements de protection et des futurs vaccins.
- Adoption de protocoles communs de surveillance épidémiologique pour une détection précoce.
- Création d’un financement préventif mutualisé pour renforcer la préparation aux crises avant qu’elles ne surviennent.
À retenir
- Le repli sur soi face aux défis mondiaux n’est pas un signe de force, mais un calcul à court terme qui engendre des coûts économiques et stratégiques élevés.
- La coopération agit comme un « multiplicateur de puissance » : elle permet à la France d’imposer ses normes (RGPD), d’accéder à la science de pointe (CERN) et de peser sur la scène internationale.
- Les instruments comme l’aide au développement ou les traités ne sont pas de la charité ou de l’angélisme, mais des investissements pragmatiques dans notre propre sécurité et prospérité à long terme.
Au-delà des clivages : un consensus français pour un pragmatisme planétaire
L’idée que la coopération internationale est une nécessité pragmatique n’est pas l’apanage d’un camp politique. En France, elle constitue en réalité un fil rouge de notre diplomatie, un consensus transpartisan qui a survécu aux alternances. De Charles de Gaulle, qui défendait une « certaine idée de la France » passant par un rôle actif sur la scène mondiale, à Emmanuel Macron, promoteur du multilatéralisme, la continuité est frappante. Cette tradition illustre que la défense des intérêts nationaux a toujours intégré la nécessité de s’allier pour peser.
Même des sujets traditionnellement associés à la gauche, comme la justice fiscale internationale, sont aujourd’hui abordés avec un pragmatisme partagé. Comme le souligne une analyse politique sur le sujet, « la justice fiscale internationale n’est plus un sujet idéologique, c’est un moyen de récupérer des recettes pour financer les services publics français ». La lutte contre l’évasion fiscale des multinationales est devenue une question de souveraineté budgétaire, un enjeu qui transcende les clivages.
Cette convergence démontre que la coopération internationale est sortie du champ de l’idéologie pour entrer dans celui de la realpolitik. Le véritable débat n’est plus « pour ou contre » la coopération, mais « comment » coopérer de la manière la plus efficace pour maximiser les intérêts français. Le souverainisme du XXIe siècle ne peut être celui de l’isolement, qui conduit à l’impuissance. Le souverainisme intelligent est celui qui comprend que pour rester maître de son destin, il faut être à la table où se décident les règles du jeu mondial.
En définitive, le choix n’est pas entre la souveraineté et la coopération, mais entre une souveraineté de façade, isolée et impuissante, et une souveraineté réelle, exercée à travers des alliances stratégiques. Pour évaluer lucidement la place de la France dans le monde, l’étape suivante consiste à analyser chaque dossier international non pas à travers le prisme de l’idéologie, mais à travers celui, bien plus réaliste, du coût de l’inaction et des bénéfices de l’alliance.