
Obsédés par la rentabilité, nous oublions que la véritable performance d’un service public réside dans sa capacité à générer des bénéfices non-monétaires, qui sont le véritable capital d’une nation.
- La logique de marché est incapable de valoriser les missions essentielles comme la cohésion sociale, l’égalité d’accès ou la stabilité des territoires.
- La privatisation et la dématérialisation à outrance créent de nouvelles fractures et dégradent la qualité du service rendu, en particulier pour les plus fragiles.
Recommandation : Il est urgent de redéfinir les indicateurs de performance des services publics pour mesurer leur impact réel sur la société, et non plus seulement leur coût budgétaire.
La scène est familière pour des millions de nos concitoyens : un guichet de gare fermé, une classe surchargée, des heures d’attente pour une démarche administrative simple. Le diagnostic, souvent asséné avec la froideur d’un consultant, est toujours le même : le service public « coûte trop cher », il n’est « pas assez rentable ». Cette obsession de la performance financière, importée du monde de l’entreprise, est en train de nous faire perdre de vue l’essentiel. Car juger un hôpital, une école ou un bureau de poste avec les mêmes outils qu’une start-up est une profonde erreur d’analyse.
Sur le terrain, nous, agents du service public, voyons chaque jour les limites de cette vision comptable. Nous savons que la fermeture d’une ligne de train en zone rurale n’est pas une simple « optimisation des coûts », mais un pas de plus vers l’isolement de tout un territoire. Nous savons que la dématérialisation à marche forcée, présentée comme une évidence moderne, se transforme en un mur infranchissable pour une partie de la population. L’idée que le privé ferait systématiquement mieux ou que le numérique résoudrait tout est un mythe tenace qui se heurte à la réalité du quotidien.
Mais si la véritable clé n’était pas de chercher à tout prix la rentabilité, mais plutôt de réaffirmer la nature profonde du service public ? Sa vraie valeur ne se trouve pas dans un bilan financier, mais dans sa capacité à créer du lien, à garantir l’égalité et à construire le socle de confiance sur lequel repose notre société. Cet article propose de dépasser les idées reçues pour explorer la richesse et la complexité de cette mission, loin des caricatures et des tableurs Excel.
Pour ceux qui préfèrent un format condensé, la vidéo suivante résume l’essentiel des points abordés dans notre guide, en explorant les différentes facettes de l’entreprise publique et sa distinction fondamentale avec le secteur privé.
Cet article va donc décortiquer les mécanismes qui rendent le service public unique et irremplaçable. Nous verrons pourquoi sa logique échappe au marché, analyserons l’impact de son recul sur les territoires et déconstruirons les mythes sur la privatisation avant d’explorer les solutions innovantes qui se dessinent pour l’avenir.
Sommaire : Comprendre la valeur inestimable du service public français
- Pourquoi la distribution du courrier ou l’accès à l’eau ne seront jamais des commerces comme les autres
- La France des « laissés-pour-compte » : enquête sur l’impact de la disparition des services publics hors des métropoles
- Le mythe de la supériorité du privé : quand la privatisation des services publics tourne au fiasco
- Le piège du « tout numérique » : comment la dématérialisation des services publics est en train de créer une nouvelle fracture sociale
- Maison France Services, budgets participatifs, agents itinérérants : les solutions qui réinventent le service public de demain
- Comment un État fort peut-il être le meilleur rempart contre la « France périphérique » ?
- Clubs de sport, associations culturelles, entraide de quartier : le rôle vital du monde associatif que la politique ignore trop souvent
- Un secteur public fort, garant de notre souveraineté et de notre avenir
Pourquoi la distribution du courrier ou l’accès à l’eau ne seront jamais des commerces comme les autres
La différence fondamentale entre un service public et une entreprise ne tient pas à son statut, mais à sa finalité. Une entreprise cherche à maximiser son profit pour ses actionnaires. Un service public vise à garantir un droit fondamental ou à fournir un bien essentiel à tous les citoyens, sans discrimination de revenus ou de lieu de résidence. Cette mission d’intérêt général repose sur des principes de solidarité et d’égalité qui sont étrangers à la logique de marché.
L’accès à l’eau potable, à l’énergie, à l’éducation ou à la santé ne peut être laissé aux seules lois de l’offre et de la demande. Ces « biens communs » génèrent ce que les économistes appellent des externalités positives : un citoyen en bonne santé contribue au bien-être de toute la collectivité, une population bien formée est un atout pour l’économie entière. Comme le souligne un rapport académique sur les biens communs, ces bénéfices, comme la cohésion sociale ou la santé publique, ne sont pas quantifiables en euros et sont donc ignorés par une gestion purement commerciale.
Le facteur humain est également au cœur de cette distinction. Le passage du facteur dans un village isolé n’est pas seulement une livraison de courrier ; c’est un lien social, une présence rassurante, parfois la seule visite de la journée pour une personne âgée. Tenter de rendre ce service « rentable » en supprimant les tournées les moins denses, c’est détruire cette valeur sociale invisible mais cruciale. C’est cette vision à long terme qui prime, comme le résume parfaitement l’économiste Laurent Cordonnier :
« La gestion publique d’une ressource vitale comme l’eau engage une responsabilité intergénérationnelle qui dépasse les logiques de rentabilité à court terme. »
– Laurent Cordonnier, Eclairages sur la notion de biens communs
Ainsi, la valeur du service public ne se mesure pas à l’aune de ses profits, mais à sa capacité à maintenir le tissu social et à garantir l’égalité républicaine sur l’ensemble du territoire.
La France des « laissés-pour-compte » : enquête sur l’impact de la disparition des services publics hors des métropoles
Lorsque la logique de rentabilité prend le pas sur la mission de service public, les premières victimes sont toujours les territoires les moins denses. La fermeture d’une trésorerie, d’un bureau de poste ou d’une maternité n’est jamais un événement anodin. C’est un signal d’abandon envoyé à des millions de Français, qui nourrit un sentiment de déclassement et une profonde crise de confiance envers les institutions.
Cette réalité est crûment illustrée par les chiffres. Un sondage de 2023 révèle que 60% des ruraux constatent une dégradation de l’accès aux services publics et même 66% aux services de santé. Loin d’être un simple « ressenti », il s’agit d’une dégradation concrète des conditions de vie : des kilomètres supplémentaires à parcourir pour un soin, des démarches administratives qui deviennent un casse-tête, et une perte d’attractivité pour le territoire.
Cette fracture territoriale est un véritable défi pour la cohésion nationale, isolant une partie de la population et la privant d’un accès équitable aux services fondamentaux.
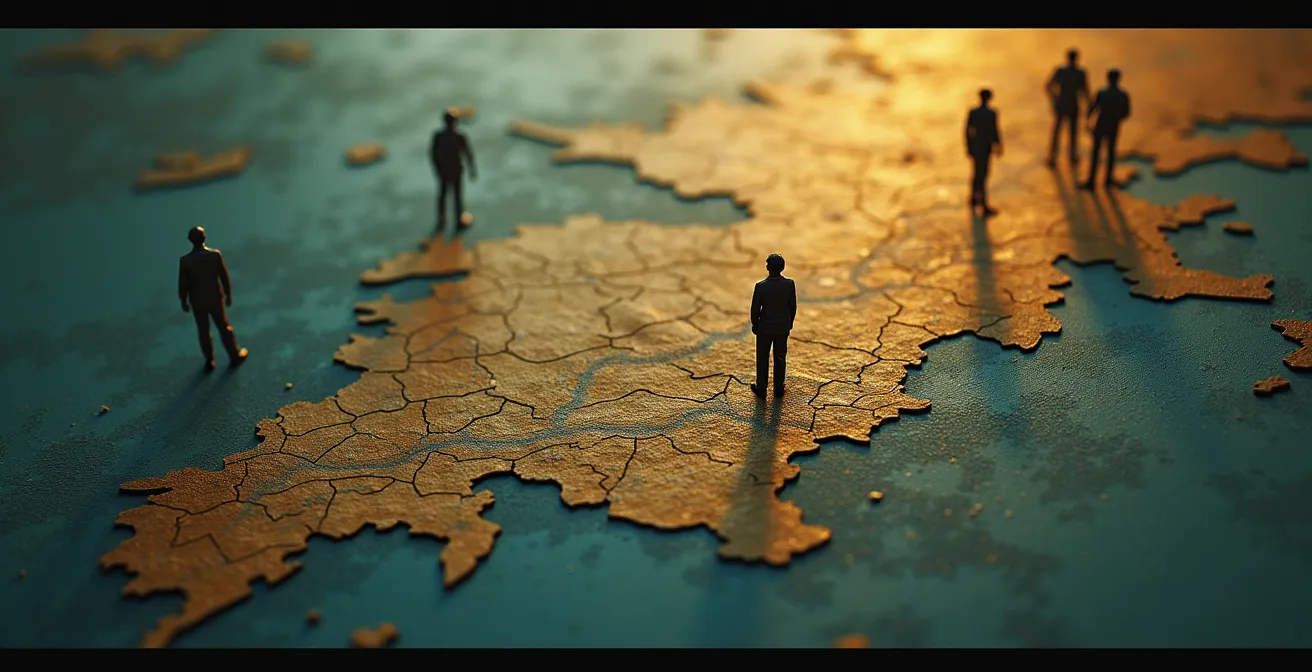
En réponse, les pouvoirs publics ont mis en place des dispositifs comme les espaces France Services. Si l’initiative est louable, elle peine à compenser le recul général. Ces maisons de service public tentent de rassembler en un seul lieu les démarches de plusieurs administrations, mais leur déploiement reste très insuffisant, ne couvrant qu’une infime partie des communes rurales. Comme l’exprime le député Philippe Brun, cette situation n’est pas sans conséquences politiques : « La disparition des services publics exacerbe le sentiment d’abandon et participe à une défiance croissante envers les institutions. »
Cette France des « laissés-pour-compte » n’est pas une fatalité, mais le résultat de choix politiques qui ont privilégié une vision comptable au détriment de l’aménagement équilibré du territoire.
Le mythe de la supériorité du privé : quand la privatisation des services publics tourne au fiasco
Face aux difficultés budgétaires, l’idée de confier la gestion de services publics au secteur privé est souvent présentée comme une solution miracle. La promesse est séduisante : plus d’efficacité, des coûts moindres pour le contribuable, une meilleure qualité de service. Pourtant, de nombreux exemples en France et à l’étranger démontrent que cette promesse est rarement tenue, et que la privatisation peut même conduire à des fiascos financiers et sociaux.
L’un des cas les plus emblématiques est celui des concessions autoroutières en France. Loin d’avoir bénéficié à l’usager, la privatisation a surtout permis des montages financiers extrêmement lucratifs pour les entreprises concessionnaires. Le mécanisme est bien rodé, comme le montre l’étude de cas suivante.
Étude de cas : Les dérives financières des concessions autoroutières
Lors de la privatisation, les entreprises ont massivement eu recours à des opérations de rachat par endettement (LBO). Concrètement, la dette contractée pour acheter les autoroutes a été transférée à la société concessionnaire elle-même. Résultat : ce sont les usagers, via les péages, qui remboursent une dette servant à enrichir les actionnaires. Cet argent, orienté vers le service de la dette, n’est plus disponible pour l’investissement et l’entretien à long terme du réseau, transformant un bien public en une machine à cash au détriment de l’intérêt général.
Ce schéma n’est pas une exception. Des expérimentations de privatisation dans des secteurs aussi sensibles que les prisons ou les services d’insertion à l’étranger ont montré des dérives systémiques similaires, où la recherche de profit se fait au détriment de la mission principale. La logique de rentabilité pousse à réduire les coûts sur le personnel, la formation ou la maintenance, avec des conséquences parfois dramatiques. Il faut aussi noter que cette mise en concurrence n’est pas toujours un choix souverain, mais souvent une contrainte imposée par des directives extérieures, comme le souligne un expert : « La mise en concurrence systématique imposée par les directives européennes présente souvent la privatisation comme une contrainte extérieure et non un choix souverain. »
Le mythe d’un secteur privé par nature plus efficace que le public s’effondre donc lorsqu’il est confronté à la réalité des faits. La recherche du profit à court terme est souvent incompatible avec la gestion d’un bien commun sur le long terme.
Le piège du « tout numérique » : comment la dématérialisation des services publics est en train de créer une nouvelle fracture sociale
Présentée comme le symbole de la modernisation de l’État, la dématérialisation des services publics était censée simplifier la vie des citoyens et réduire les coûts de fonctionnement. Si elle offre des avantages indéniables pour une partie de la population, cette transition menée à marche forcée a également ouvert un véritable gouffre pour les autres, créant une nouvelle forme d’exclusion : la fracture numérique.
Cette fracture n’est pas qu’une question d’équipement. Elle est avant tout humaine. D’après une étude de l’INSEE, 15,4% de la population française manquait de compétences numériques de base en 2021. Il s’agit de millions de personnes (personnes âgées, personnes en situation de précarité, personnes peu diplômées) pour qui créer un espace personnel, scanner un document ou remplir un formulaire en ligne complexe est une épreuve insurmontable. Pour eux, la « simplification » numérique est en réalité une barrière infranchissable qui les prive de l’accès à leurs droits.
Cette personne désemparée face à un écran est le visage d’une fracture qui n’est pas seulement technique, mais aussi cognitive, rendant l’accès aux services publics plus difficile pour ceux qui en ont le plus besoin.
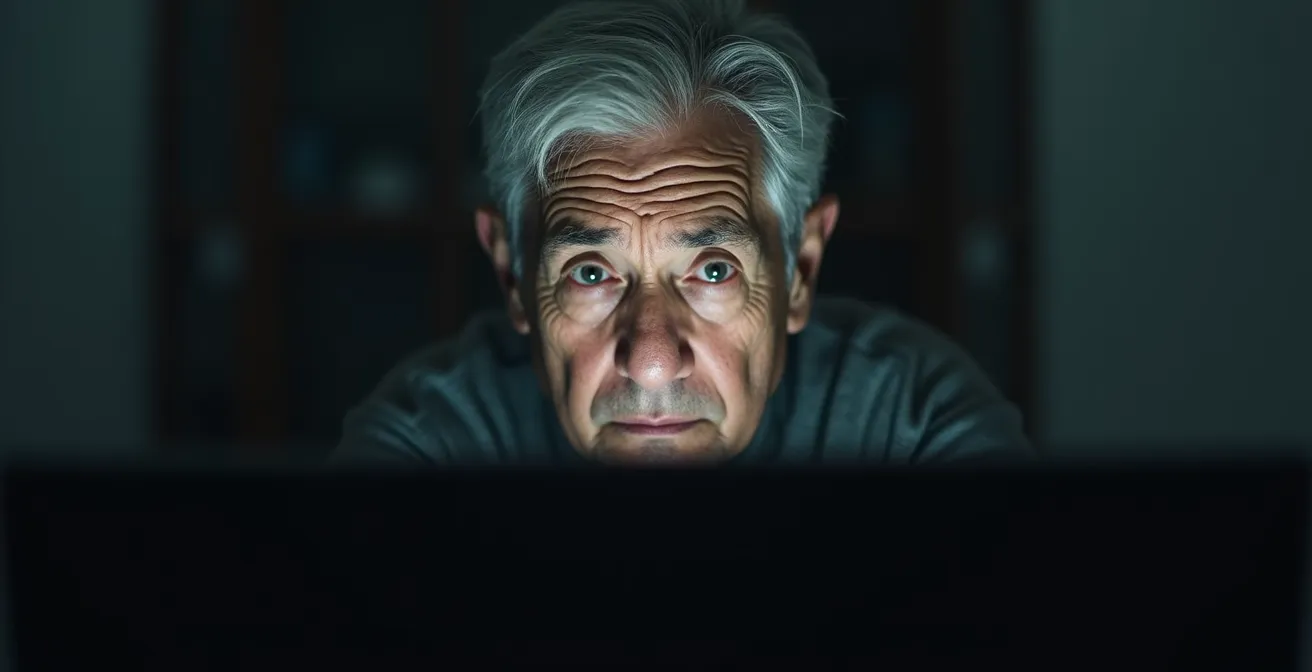
Le paradoxe est que cette déshumanisation est parfois coûteuse. La gestion des réclamations et des erreurs générées par des systèmes en ligne mal conçus nécessite souvent en coulisses plus d’agents qualifiés qu’auparavant. Comme le note un spécialiste, « la fracture numérique ne se limite pas à l’accès matériel mais s’étend à la capacité cognitive à utiliser les services dématérialisés, souvent complexifiés. » Loin de l’image d’une administration agile et efficace, le « tout numérique » a trop souvent abouti à des plateformes impersonnelles et anxiogènes, qui reportent la charge de la complexité administrative sur l’usager.
La solution n’est pas de rejeter le numérique, mais de le concevoir comme un outil au service de tous, en maintenant toujours un guichet humain pour ceux qui en ont besoin. La technologie doit être un pont, pas un mur.
Maison France Services, budgets participatifs, agents itinérants : les solutions qui réinventent le service public de demain
Critiquer les dérives de la vision purement comptable du service public ne signifie pas refuser toute évolution. Au contraire, face aux nouveaux défis sociaux et territoriaux, des solutions innovantes émergent partout en France pour réinventer un service public plus proche, plus humain et plus efficace. Loin d’une administration rigide et centralisée, ces initiatives dessinent les contours d’un État agile qui fait confiance à ses agents de terrain.
Les Maisons France Services sont l’une des incarnations de ce renouveau. En regroupant en un seul lieu des agents polyvalents capables d’accompagner les usagers dans leurs démarches, elles recréent le lien de proximité qui avait disparu. Bien que leur couverture reste un défi, un rapport de 2024 montre que 68% de ces espaces sont situés en zone rurale, là où le besoin est le plus criant. Mais cette proximité ne doit pas être que géographique ; elle doit aussi être décisionnelle. Donner plus d’autonomie aux agents de terrain leur permet de construire des réponses adaptées aux réalités locales, une approche qualifiée de « slow public management ».
L’innovation passe aussi par une plus grande participation citoyenne. Les budgets participatifs, qui permettent aux habitants de proposer et de voter pour des projets d’intérêt local, ou la mise en place d’agents itinérants pour aller à la rencontre des publics les plus isolés, sont autant de manières de co-construire le service public de demain. Ces solutions partagent une même philosophie : faire de l’usager un partenaire et non un simple consommateur.
Plan d’action : 5 leviers pour réinventer le service public
- Établir un Indice de Valeur Publique (IVP) : Créer un indicateur qui mesure la cohésion sociale, la confiance et le bien-être, pour compléter les indicateurs purement budgétaires.
- Développer la gestion publique des biens communs : Renforcer l’expertise publique dans des secteurs stratégiques comme l’eau, l’énergie et le numérique pour piloter la transition écologique.
- Encourager le « slow public management » : Donner plus d’autonomie, de temps et de moyens aux agents de terrain pour qu’ils puissent apporter des réponses humaines et personnalisées.
- Promouvoir la proximité active : Développer massivement les budgets participatifs et les services itinérants pour toucher les publics isolés et adapter l’action publique aux besoins réels.
- Renforcer les Maisons France Services : Élargir leurs moyens, étendre leurs horaires et améliorer leur couverture territoriale pour en faire la véritable porte d’entrée du service public.
Ces initiatives prouvent qu’une autre voie est possible. Une voie où la modernisation ne rime pas avec déshumanisation, mais avec plus de proximité, de confiance et de coopération.
Comment un État fort peut-il être le meilleur rempart contre la « France périphérique » ?
Lutter contre la fracture territoriale, ce n’est pas seulement une question de justice sociale, c’est un impératif stratégique pour la cohésion du pays. Dans ce combat, un État fort et investisseur est le meilleur allié des territoires en difficulté. Loin de l’image d’un État centralisateur et bureaucratique, il s’agit de penser un État stratège, capable d’orienter le développement, de corriger les déséquilibres créés par le marché et de garantir une égalité réelle des chances pour tous les citoyens, où qu’ils vivent.
L’investissement public est le moteur principal de cette stratégie. Contrairement à une idée reçue, la dépense publique dans les territoires n’est pas un coût, mais un investissement au retour sur investissement social et économique puissant. Un rapport officiel du ministère du Budget de 2024 estime que chaque euro investi dans une infrastructure locale (école, route, réseau numérique) génère plusieurs euros d’activité économique privée en retour. Il crée un effet d’entraînement en attirant des entreprises, en fixant des familles et en dynamisant le commerce local.
La présence de fonctionnaires joue également un rôle de stabilisateur économique souvent sous-estimé. Dans une commune rurale, l’école, l’hôpital ou le bureau de poste sont non seulement des services essentiels, mais aussi des employeurs majeurs. Le revenu stable et non délocalisable d’un agent public soutient la consommation locale et permet de maintenir un tissu économique viable là où le marché seul ne le ferait pas. L’État n’est donc pas « hors-sol » ; il est un acteur économique et social profondément ancré dans la vie des territoires.
Penser l’État comme un simple gestionnaire de coûts, c’est se condamner à gérer le déclin. Le penser comme un investisseur, c’est se donner les moyens de préparer l’avenir et de garantir que la promesse républicaine d’égalité ne s’arrête pas aux portes des métropoles.
Clubs de sport, associations culturelles, entraide de quartier : le rôle vital du monde associatif que la politique ignore trop souvent
Parler de service public en se limitant à l’administration d’État serait une erreur. À côté des services régaliens et des grandes administrations, un autre acteur joue un rôle tout aussi vital, mais souvent invisible : le monde associatif. Clubs sportifs, associations culturelles, réseaux d’entraide… Ce tissu dense et diversifié est un véritable service public de fait, qui crée du lien social, de l’éducation et du bien-être là où l’État ne peut pas toujours aller.
L’importance de ce secteur est massive, y compris sur le plan économique. Un rapport de 2023 sur le secteur associatif estime que les associations représentent 3,5% du PIB français, avec un budget cumulé de plus de 113 milliards d’euros. Derrière ces chiffres se cachent des millions de bénévoles et de salariés qui œuvrent au quotidien pour des missions d’intérêt général : prévention de la santé, lutte contre l’isolement, éducation populaire, accès à la culture pour tous.
Pourtant, la relation entre l’État et le monde associatif est ambivalente. D’un côté, l’État délègue de plus en plus de missions aux associations, reconnaissant leur agilité et leur connaissance fine du terrain. De l’autre, il les fragilise par des baisses de subventions et une complexité administrative croissante. Comme le souligne un chercheur, « le monde associatif joue un rôle de service public de fait, souvent dans des conditions précaires ». Cette précarité met en danger la continuité de leurs actions, qui sont pourtant essentielles à l’équilibre de notre société.
Soutenir le monde associatif, ce n’est pas une simple dépense, c’est investir dans le « capital social » du pays. C’est reconnaître que la force d’une nation repose aussi sur l’engagement de ses citoyens et sur la vitalité des corps intermédiaires qui tissent le lien social au quotidien.
À retenir
- La valeur d’un service public ne se mesure pas en euros mais en bénéfices non-monétaires comme la cohésion sociale, l’égalité et la confiance.
- Le recul des services publics, motivé par une logique de rentabilité, crée une fracture territoriale et un sentiment d’abandon, en particulier dans les zones rurales.
- Les solutions d’avenir reposent sur la proximité, l’innovation locale (Maisons France Services, agents itinérants) et la reconnaissance du rôle vital du monde associatif.
Un secteur public fort, garant de notre souveraineté et de notre avenir
Au-delà de la cohésion sociale et de l’aménagement du territoire, un secteur public fort est aujourd’hui la condition sine qua non de notre souveraineté collective. Les crises récentes – sanitaire, énergétique, climatique – l’ont démontré avec force : un État capable de planifier, d’investir et de piloter des stratégies de long terme est un atout indispensable pour protéger les citoyens et préparer l’avenir. Le marché, par sa nature court-termiste, est incapable de relever seul ces défis systémiques.
La souveraineté sanitaire passe par un hôpital public robuste et des agences de santé dotées de moyens. La souveraineté énergétique exige des entreprises publiques capables de mener une transition écologique ambitieuse et de garantir la sécurité d’approvisionnement. La souveraineté numérique dépend de notre capacité à développer des services publics en ligne qui protègent les données des citoyens. Dans tous ces domaines, le service public n’est pas une dépense, mais un investissement stratégique dans notre autonomie et notre résilience.
Cette vision est au cœur de la planification écologique. Le dispositif Services Publics Écoresponsables (SPE), par exemple, mobilise les 2,5 millions d’agents de la fonction publique d’État pour transformer les pratiques de l’administration. Selon une source officielle du ministère de l’Écologie, cette initiative vise à faire de l’État un acteur exemplaire de la transition. C’est la preuve qu’un secteur public mobilisé est le levier le plus puissant pour opérer les changements d’échelle nécessaires.
En définitive, défendre le service public, ce n’est pas défendre un modèle passéiste. C’est affirmer qu’il est l’outil le plus moderne et le plus efficace pour garantir l’égalité, renforcer notre cohésion et maîtriser notre destin commun. Pour cela, il est impératif de changer de paradigme et de mesurer enfin sa performance à l’aune de sa seule vraie valeur : celle qu’il apporte à chaque citoyen.