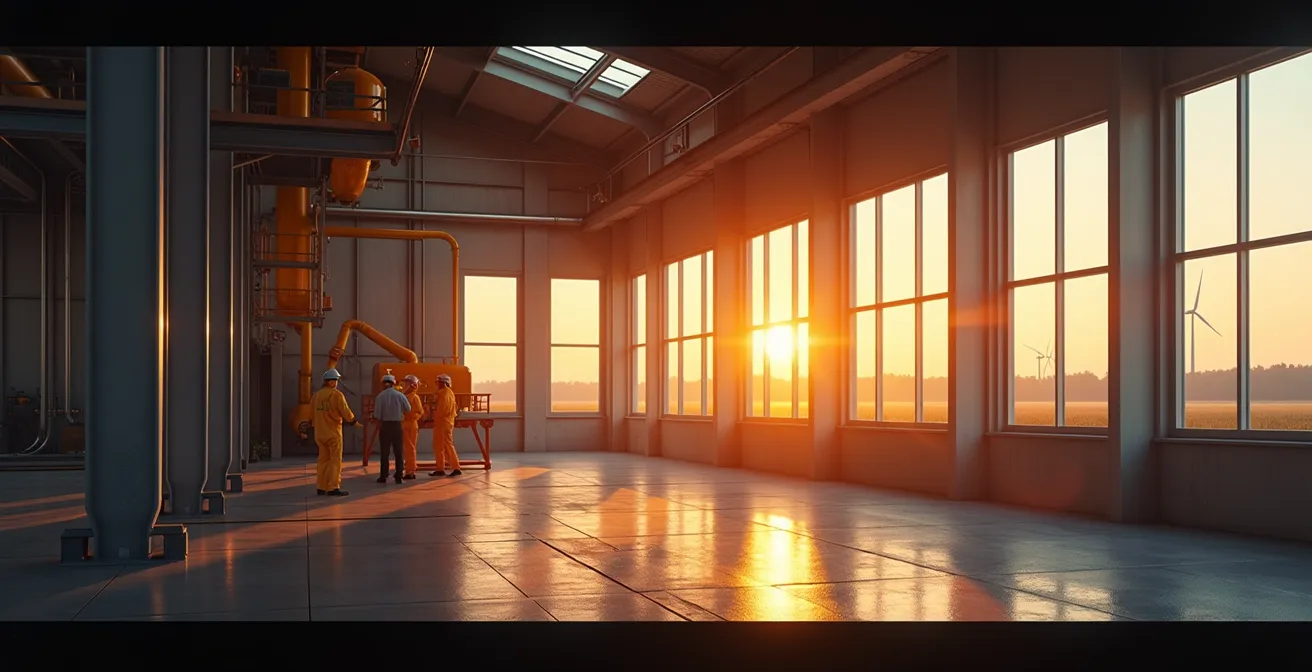
La relocalisation n’est pas un retour en arrière coûteux, mais l’investissement le plus pragmatique et le plus rentable pour garantir notre avenir collectif et notre autonomie.
- Elle met fin à une dépendance dangereuse pour les produits vitaux (médicaments, composants) révélée par les crises récentes.
- Elle constitue le levier le plus puissant pour une transition écologique concrète en réduisant l’empreinte carbone des transports mondiaux.
Recommandation : Il est impératif de cesser de percevoir le « Produire en France » comme un simple coût pour le reconnaître comme ce qu’il est vraiment : une assurance-vie nationale.
Vous souvenez-vous des rayons de supermarchés vides, de la course folle pour trouver des masques ou même une simple boîte de paracétamol ? La crise du Covid a été un électrochoc brutal. Pour la première fois depuis des décennies, nous, citoyens d’un pays riche et moderne, avons physiquement ressenti notre fragilité. Nous avons compris dans notre chair que la mondialisation, qu’on nous présentait comme une évidence économique, avait un coût caché : notre dépendance. Face à ce constat, le débat sur la relocalisation a refait surface. Mais il est souvent caricaturé, piégé entre deux visions : d’un côté, une nostalgie passéiste d’une France industrielle révolue ; de l’autre, l’accusation de protectionnisme, de repli sur soi.
Mais si cette vision était complètement inversée ? Si la véritable folie, l’aberration économique et stratégique, était de continuer comme avant ? Je ne parle pas ici avec la froideur d’un économiste, mais avec le pragmatisme d’un ingénieur qui a vu nos usines fermer les unes après les autres. Relocaliser n’est pas un caprice nationaliste. C’est un acte de bon sens, une stratégie de survie. Il ne s’agit pas de tout produire en France, mais de rapatrier ce qui est vital. Il ne s’agit pas de rejeter le monde, mais de restaurer notre capacité à tenir debout par nous-mêmes face à la prochaine tempête. Cet article n’est pas un plaidoyer pour le passé, mais une feuille de route pour un avenir où la France retrouve la maîtrise de son destin, en faisant de sa réindustrialisation le moteur de sa résilience et de sa transition écologique.
Pour comprendre les enjeux de cette reconquête, nous analyserons d’abord l’étendue de notre dépendance, avant d’identifier les secteurs prioritaires à rapatrier. Nous déconstruirons ensuite les fausses excuses qui freinent ce mouvement, pour enfin dessiner les contours d’une souveraineté économique moderne, à la fois écologique et européenne.
Sommaire : La reconquête industrielle de la France, un impératif de souveraineté
- La folie des chaînes de valeur mondiales : comment la recherche du coût le plus bas nous a rendus totalement dépendants
- Médicaments, batteries, puces électroniques : la liste des productions qu’il faut absolument relocaliser pour notre sécurité
- Le coût du travail, la fausse excuse de la désindustrialisation : pourquoi la France a tous les atouts pour redevenir une grande nation industrielle
- La souveraineté alimentaire : l’art de bien nourrir sa population sans dépendre du reste du monde
- Comment faire de la réindustrialisation le moteur de la transition écologique ?
- Vente d’Alstom, de Technip, des Chantiers de l’Atlantique : comment la France a bradé ses fleurons industriels
- Airbus, vaccins, plan de relance : quand l’Europe se réveille et agit comme une puissance
- Assurer la souveraineté économique
La folie des chaînes de valeur mondiales : comment la recherche du coût le plus bas nous a rendus totalement dépendants
Pendant des décennies, le dogme était simple : produire là où c’est le moins cher. On nous a vendu une « optimisation » des chaînes de valeur, une division internationale du travail qui devait apporter la prospérité à tous. Le résultat ? Une hémorragie. Comme le rappelle cruellement la journaliste Ella Cerfontaine dans le documentaire « Qui a tué l’industrie française ? », « en cinquante ans, la France s’est vidée de près de la moitié de ses usines et du tiers de son emploi industriel ». Cette phrase n’est pas une opinion, c’est un constat clinique. Nous avons méthodiquement démantelé notre outil de production, pièce par pièce, au nom d’une logique comptable à court terme.
Les chiffres sont sans appel. La part de l’industrie manufacturière dans notre richesse nationale s’est effondrée. Selon l’Insee, la part de l’industrie dans le PIB français a chuté de 17% à 11% entre 1995 et 2017. Nous avons pensé gagner en pouvoir d’achat en important des produits à bas coût, mais nous avons perdu bien plus : notre savoir-faire, nos emplois qualifiés et, surtout, notre autonomie. Cette dépendance n’est pas seulement matérielle, elle est aussi capitalistique. Le fait que les sociétés du Cac 40 soient détenues à 58% par des investisseurs étrangers montre à quel point les décisions stratégiques qui concernent nos plus grandes entreprises peuvent nous échapper. La recherche du coût le plus bas nous a coûté notre souveraineté.
Médicaments, batteries, puces électroniques : la liste des productions qu’il faut absolument relocaliser pour notre sécurité
La prise de conscience post-Covid a mis en lumière une vérité simple : certains biens ne sont pas des marchandises comme les autres. Leur disponibilité relève de la sécurité nationale. En tête de liste figurent les produits de santé. L’incapacité de la France, sixième puissance mondiale, à produire massivement du paracétamol ou des masques a été une humiliation et un avertissement. Nous avons découvert que 80% des principes actifs de nos médicaments étaient fabriqués hors d’Europe, principalement en Chine et en Inde. Rapatrier la production de ces molécules essentielles n’est pas une option, c’est un impératif vital.
Ce paragraphe introduit un concept complexe. Pour bien le comprendre, il est utile de visualiser ses composants principaux. L’illustration ci-dessous décompose ce processus.

Au-delà de la santé, la double transition numérique et écologique dessine les nouvelles frontières de la souveraineté. Sans puces électroniques, pas de voitures, pas de smartphones, pas d’objets connectés, pas de défense. Or, l’Europe ne produit que 10% des semi-conducteurs mondiaux. De même, sans batteries électriques, pas de transition vers le véhicule propre, pas de stockage pour les énergies renouvelables. Dépendre de l’Asie pour ces composants, c’est accepter de subir les choix technologiques et les ruptures d’approvisionnement décidés par d’autres. Heureusement, une dynamique s’amorce, même timidement. Le plan France Relance a déjà permis d’accompagner près de 155 projets de relocalisation depuis 2020.
Le coût du travail, la fausse excuse de la désindustrialisation : pourquoi la France a tous les atouts pour redevenir une grande nation industrielle
L’argument tombe comme un couperet à chaque débat : « on ne peut pas relocaliser, le coût du travail est trop élevé en France ». C’est un argument paresseux, une vision de l’industrie digne du XIXe siècle. Comme le souligne une étude parue dans The Conversation, cette obsession est une forme de désinformation : « la main d’œuvre et son coût sont aujourd’hui englobés dans un format plus vaste qui inclut la formation, la qualification des salariés ». Dans une usine moderne, robotisée et performante, le coût de la main-d’œuvre directe ne représente souvent qu’une part minoritaire du coût de revient total (10 à 20%).
Ce qui compte vraiment, c’est la productivité globale. Un ouvrier français qualifié, opérant une machine-outil de pointe, est infiniment plus productif qu’un travailleur sous-payé à l’autre bout du monde. La France dispose d’atouts maîtres : des ingénieurs parmi les meilleurs, une électricité décarbonée et compétitive, des infrastructures de transport de premier plan et un écosystème d’innovation puissant. L’industrie du futur n’est pas celle des bas salaires, mais celle de l’intelligence, de l’automatisation et de la qualité. La dynamique est d’ailleurs enclenchée : le Baromètre industriel de l’État a confirmé la poursuite de la réindustrialisation avec 89 ouvertures nettes de sites industriels en 2024. C’est la preuve que c’est possible.
Plan d’action : évaluer la pertinence d’une relocalisation
- Analyse de la chaîne de valeur : Identifier les maillons critiques et les dépendances géopolitiques à risque (fournisseurs uniques, zones de tension).
- Calcul du coût complet : Intégrer au-delà du coût de production les frais de transport, les risques de rupture, l’impact carbone et le coût de la non-qualité.
- Audit des compétences locales : Évaluer la disponibilité du savoir-faire technique et des filières de formation nécessaires en France.
- Potentiel d’automatisation : Définir dans quelle mesure la robotisation et l’industrie 4.0 peuvent compenser les différentiels de coût de main-d’œuvre.
- Analyse de marché : Mesurer l’appétence des consommateurs pour un produit « Made in France », gage de qualité, de traçabilité et de responsabilité.
La souveraineté alimentaire : l’art de bien nourrir sa population sans dépendre du reste du monde
La souveraineté ne se limite pas aux puces électroniques ou aux médicaments. Elle commence dans notre assiette. La France, grande puissance agricole, a elle aussi cédé aux sirènes de la mondialisation alimentaire, créant des dépendances absurdes. Nous importons de l’ail de Chine, des poulets de Pologne ou des tomates du Maroc, alors même que nos agriculteurs peinent à vivre de leur travail. La souveraineté alimentaire, ce n’est pas l’autarcie, mais la capacité d’un pays à définir sa propre politique agricole et alimentaire pour nourrir durablement sa population.
Cela passe par la relocalisation de nos filières agro-industrielles, en recréant un lien fort entre le champ et l’usine. L’exemple de la marque Benedicta est éclairant. En décidant de s’approvisionner localement pour ses œufs et son huile de colza, malgré un surcoût et un investissement d’un million d’euros, l’entreprise a répondu à une attente forte des consommateurs et sécurisé sa production. Cette démarche n’est pas isolée. Selon une enquête de CCI France sur la relocalisation, près de 46,5% des chefs d’entreprise expriment la volonté de recourir davantage à des fournisseurs français. Le consommateur-citoyen a un rôle clé à jouer en privilégiant les produits dont l’origine est clairement tracée.
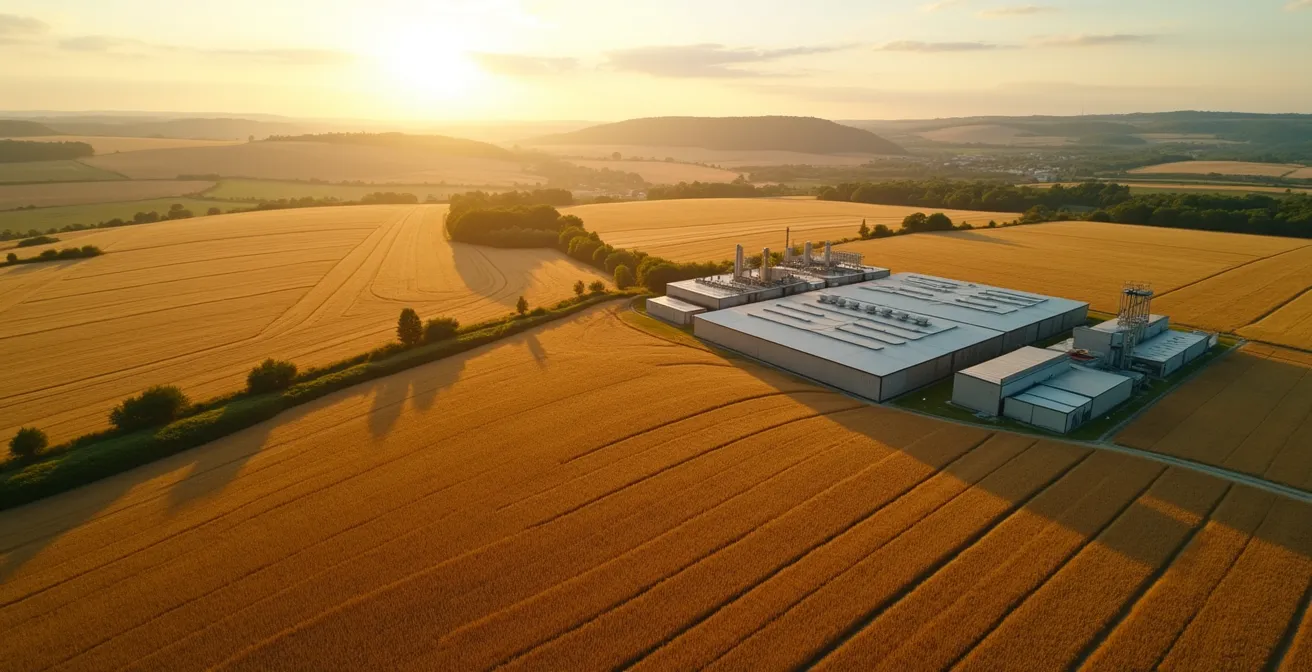
Assurer notre souveraineté alimentaire, c’est aussi un enjeu de résilience face au changement climatique et aux crises géopolitiques qui peuvent à tout moment perturber les flux logistiques mondiaux. Reconstruire des filières locales complètes, de la semence à l’assiette, est une police d’assurance pour notre avenir.
Comment faire de la réindustrialisation le moteur de la transition écologique ?
L’un des arguments les plus pervers contre la réindustrialisation est d’ordre écologique. On a longtemps cru que délocaliser nos usines « sales » était une bonne chose pour les émissions de CO2 de la France. C’est un mensonge par omission. Comme l’analyse lucidement L’Usine Nouvelle, si la désindustrialisation a bien provoqué une baisse des émissions territoriales, « dans le même temps, l’empreinte carbone provoquée par la hausse des produits importés dans l’Hexagone est montée en flèche ». En d’autres termes, nous n’avons pas arrêté de polluer, nous avons simplement exporté notre pollution, souvent vers des pays aux normes environnementales bien moins strictes.
La désindustrialisation aurait provoqué une baisse des émissions de CO2 de 9% en France depuis 1973. Dans le même temps, l’empreinte carbone provoquée par la hausse des produits importés dans l’Hexagone est montée en flèche.
La réindustrialisation est donc notre meilleure arme pour une écologie concrète et non hypocrite. Produire en France, c’est d’abord réduire drastiquement l’impact carbone lié au transport maritime et aérien. C’est ensuite garantir le respect des normes environnementales et sociales les plus exigeantes au monde. Enfin, c’est innover pour créer l’industrie « verte » de demain : usines moins énergivores, économie circulaire, nouveaux matériaux biosourcés. La relocalisation n’est pas l’ennemie de l’écologie, elle en est la condition sine qua non.
Étude de cas : Le succès de Rossignol, entre relocalisation et écologie
L’entreprise iséroise Rossignol est un exemple emblématique. Après avoir rapatrié la fabrication de 100 000 paires de skis depuis Taïwan, elle ne s’est pas arrêtée là. Elle a développé une nouvelle gamme de skis « Essentiel », 100% made in France et recyclables à 77%. Résultat : l’entreprise a non seulement réduit son empreinte carbone mais a aussi vu son chiffre d’affaires bondir de 28%, prouvant que réindustrialisation, innovation écologique et succès commercial peuvent aller de pair.
Vente d’Alstom, de Technip, des Chantiers de l’Atlantique : comment la France a bradé ses fleurons industriels
Pour comprendre où aller, il faut se souvenir d’où l’on vient et des erreurs commises. La désindustrialisation n’est pas une catastrophe naturelle, elle est aussi le fruit de décisions politiques et stratégiques. La France a laissé partir, voire bradé, certains de ses plus beaux fleurons, emportant avec eux des centres de décision, des brevets et des milliers d’emplois. Le cas d’Alstom et de sa branche énergie vendue à l’Américain General Electric reste une blessure ouverte, un symbole de l’affaiblissement de notre souveraineté dans un secteur aussi stratégique que le nucléaire.
Ce ne fut pas un cas isolé. Technip dans le secteur parapétrolier, Pechiney dans l’aluminium, ou les menaces qui ont pesé sur les Chantiers de l’Atlantique… la liste est longue. Chaque vente, justifiée par la logique de marché, était en réalité un renoncement. Ces décisions ont eu un coût social dramatique. Entre 1995 et 2017, l’industrie manufacturière française a perdu plus de 900 000 emplois. Ce ne sont pas que des statistiques, ce sont des familles, des territoires et des savoir-faire sacrifiés sur l’autel de la mondialisation.
L’ancien ministre Arnaud Montebourg, dans le documentaire « Qui a tué l’industrie française ? », pointe directement « la responsabilité de messieurs Hollande et Macron » dans l’affaire Alstom. Au-delà des responsabilités individuelles, ces épisodes doivent servir de leçon : un État ne peut pas être un simple spectateur de la vie économique. Il doit être un stratège, capable de protéger ses actifs vitaux contre les prédations étrangères, en utilisant tous les outils à sa disposition, du décret sur les investissements étrangers au soutien aux champions nationaux.
Airbus, vaccins, plan de relance : quand l’Europe se réveille et agit comme une puissance
Face aux géants américains et chinois, la reconquête industrielle de la France ne peut se jouer seule. L’échelle pertinente pour peser dans les rapports de force mondiaux est l’Europe. Longtemps naïve, l’Union Européenne semble enfin prendre la mesure des enjeux. L’exemple historique d’Airbus a montré que lorsque les Européens unissent leurs forces, leurs capitaux et leurs ingénieurs, ils peuvent créer un leader mondial capable de rivaliser avec n’importe qui. C’est ce modèle qu’il faut aujourd’hui dupliquer dans d’autres secteurs stratégiques.
La crise sanitaire a été un deuxième réveil. L’achat groupé de vaccins et l’ébauche d’une politique de souveraineté sanitaire européenne ont montré qu’une action coordonnée était possible. Le plan de relance européen, « NextGenerationEU », et ses déclinaisons nationales comme France 2030, flèchent des milliards d’euros vers la réindustrialisation, l’innovation et la transition écologique. On observe une véritable volonté politique d’agir en puissance. Depuis 2017, la politique de réindustrialisation commence à porter ses fruits avec la création de 90 000 emplois industriels et l’implantation de 300 nouvelles usines sur le territoire national.
Des programmes concrets voient le jour, comme le programme « Territoires d’industrie ». Sa deuxième phase, lancée en 2023, engage 183 territoires lauréats dans une démarche de reconquête industrielle durable, avec 100 millions d’euros mobilisés pour les accompagner. Il ne s’agit plus de discours, mais d’actions locales, au plus près des bassins d’emplois. L’Europe ne doit plus être synonyme de normes et de bureaucratie, mais d’ambition et de projets concrets, protégeant son marché intérieur tout en investissant massivement dans les technologies d’avenir.
À retenir
- La dépendance industrielle n’est pas une fatalité mais le résultat de décennies de choix stratégiques axés sur le court terme.
- Relocaliser les secteurs vitaux (santé, numérique, alimentation) est une assurance-vie contre les futures crises.
- La réindustrialisation est un puissant levier pour la transition écologique, en produisant plus propre et plus localement.
Assurer la souveraineté économique
Nous avons vu l’étendue de notre dépendance, identifié les priorités et déconstruit les mythes. Assurer notre souveraineté économique n’est finalement pas un slogan, mais une discipline de long terme qui repose sur une vision claire et des actions concrètes. La dynamique de réindustrialisation, bien que réelle, reste fragile et nécessite un soutien sans faille. L’État a un rôle irremplaçable à jouer, non pas en se substituant aux entreprises, mais en agissant comme un État-stratège.
Il ne suffit pas qu’une entreprise soit localisée en France pour que la souveraineté industrielle soit garantie. L’État doit s’engager comme régulateur face aux risques de prédation de la part des investisseurs étrangers.
Cela signifie protéger nos pépites technologiques, orienter l’épargne des Français vers l’économie réelle, simplifier les normes pour ceux qui produisent sur notre sol et mener une politique de commande publique qui favorise le « Produire en France ». Cela implique aussi de continuer à investir massivement dans la formation pour recréer les compétences industrielles que nous avons laissé disparaître. Les chiffres montrent une tendance positive, mais aussi la nécessité de ne pas relâcher l’effort, comme le prouve le ralentissement des ouvertures nettes d’usines en 2024 après des années record.
| Année | Ouvertures nettes d’usines | Évolution |
|---|---|---|
| 2022 | 176 | Forte dynamique |
| 2023 | 189 | Pic historique |
| 2024 | 89 | Ralentissement attendu |
La reconquête de notre souveraineté économique n’est pas seulement l’affaire des politiques ou des industriels. C’est un projet de société qui nous concerne tous. En tant que consommateurs, par nos choix quotidiens, nous pouvons soutenir les entreprises qui font l’effort de produire en France. En tant que citoyens, nous devons exiger de nos dirigeants une ambition et une constance à la hauteur des enjeux. Choisir de maîtriser notre destin industriel, c’est choisir un avenir plus sûr, plus écologique et plus juste.