
Contrairement à un discours répandu, considérer le secteur public comme une charge à réduire est une erreur stratégique : il est en réalité le principal investisseur dans notre avenir collectif.
- L’État est le seul acteur capable de financer les innovations de rupture et les transitions écologiques à long terme, là où le marché est souvent court-termiste.
- Il est le garant de la cohésion territoriale en assurant un accès équitable aux services essentiels, luttant contre la fracture entre métropoles et « France périphérique ».
- Par des investissements ciblés, il bâtit notre souveraineté industrielle et technologique, un enjeu crucial dans un monde incertain.
Recommandation : Il est impératif de cesser de penser l’État comme un simple centre de coût pour le voir comme le capital-risqueur de la Nation, un levier à moderniser et à renforcer pour les défis de demain.
Le débat public est saturé d’une idée simple, presque devenue un réflexe : pour que la France aille mieux, il faudrait « dégraisser le mammouth ». Le secteur public est souvent dépeint comme un poids mort, une source de dette et d’inefficacité qui entraverait le dynamisme du pays. Cette vision, axée sur la dépense immédiate, ignore une réalité fondamentale. Elle nous condamne à une gestion à court terme, à réagir aux crises plutôt qu’à les anticiper, et surtout, elle nous prive de notre principal atout pour construire l’avenir.
Car si la véritable clé n’était pas de réduire l’État, mais de le réinventer ? Et si, au lieu de le voir comme un fardeau, nous le considérions comme le plus puissant des investisseurs, le seul capable de porter une vision à long terme ? Cet article propose de renverser la perspective. Nous ne défendrons pas le service public par nostalgie d’un âge d’or révolu, mais nous démontrerons, chiffres à l’appui, qu’un État stratège, moderne et efficace est le meilleur, et peut-être le seul, investissement possible pour piloter la transition écologique, garantir l’égalité d’accès aux services essentiels et assurer notre souveraineté.
Pour bâtir cette argumentation, nous explorerons la différence fondamentale entre un État qui subit et un État qui planifie. Nous verrons comment les innovations qui façonnent notre quotidien dépendent de la recherche publique, avant de déconstruire le mythe du « trop de fonctionnaires ». Enfin, nous analyserons comment un État-investisseur est le meilleur rempart contre les fractures territoriales et un levier essentiel pour notre souveraineté, tout en esquissant les pistes d’une modernisation ambitieuse.
Sommaire : L’État-stratège, un investissement vital pour la France
- État-pompier contre État-stratège : la différence fondamentale qui détermine l’avenir d’un pays
- Votre smartphone, votre GPS, vos médicaments : toutes ces innovations que vous devez à la recherche publique
- Y a-t-il vraiment « trop de fonctionnaires » en France ? Ce que disent les comparaisons internationales
- Comment un État fort peut-il être le meilleur rempart contre la « France périphérique » ?
- Comment rendre le service public plus efficace sans le privatiser ? Les pistes pour une réforme de gauche
- La France des « laissés-pour-compte » : enquête sur l’impact de la disparition des services publics hors des métropoles
- Pourquoi le retour de l’entreprise publique est une idée d’avenir pour notre souveraineté
- La garantie des services publics : le socle de notre contrat social
État-pompier contre État-stratège : la différence fondamentale qui détermine l’avenir d’un pays
Deux visions de l’action publique s’affrontent. La première, celle de l’État-pompier, est réactive. Il intervient après la catastrophe : plans de sauvetage en cas de crise financière, chômage partiel lors d’une pandémie, aide d’urgence face aux catastrophes climatiques. Si ce rôle est indispensable, il est par nature coûteux et ne construit rien de durable. Il se contente de colmater les brèches d’un système dont il ne maîtrise pas la direction. Cette vision est celle qui nourrit le discours sur le « poids » de la dépense publique, car elle ne génère que des coûts visibles sans retours sur investissement clairs.
À l’opposé se trouve l’État-stratège. Celui-ci n’attend pas la crise, il l’anticipe et investit pour bâtir un avenir plus résilient et prospère. Il ne se contente pas de réparer, il construit. Son rôle est de fixer un cap, d’identifier les défis de long terme (transition écologique, souveraineté numérique, vieillissement de la population) et de mobiliser les ressources de la nation pour y répondre. Le plan France 2030 est l’illustration parfaite de cette démarche. Comme le souligne un rapport de la Cour des Comptes, ce sont déjà près de 35 Md€ qui ont été engagés sur une enveloppe de 50,41 Md€ pour soutenir des milliers de projets d’avenir. Il ne s’agit plus de dépenser, mais d’investir.
Le cas de Bpifrance : le bras armé de l’État-investisseur
La Banque publique d’investissement (Bpifrance) incarne cette vision. Plutôt que de subventionner à fonds perdus, elle agit comme un véritable capital-risqueur de la Nation. Elle oriente ses financements vers les PME innovantes, en particulier dans les technologies de rupture. En créant un fonds pour l’innovation de rupture, Bpifrance ne se contente pas de soutenir l’économie existante ; elle parie sur les marchés et les emplois de demain, assumant un risque que les acteurs privés, souvent plus frileux et court-termistes, ne sont pas toujours prêts à prendre.
Cette distinction est cruciale. L’État-stratège transforme la dépense publique en un amortissement collectif. L’argent injecté aujourd’hui dans la recherche sur l’hydrogène vert, dans la formation aux métiers du numérique ou dans la modernisation des infrastructures ferroviaires n’est pas une charge, mais une mise de fonds dont toute la société récoltera les bénéfices demain, en termes de compétitivité, d’emplois et de qualité de vie.
Votre smartphone, votre GPS, vos médicaments : toutes ces innovations que vous devez à la recherche publique
L’une des idées reçues les plus tenaces est celle d’un secteur privé innovant face à un secteur public bureaucratique et stérile. La réalité est bien plus nuancée. De nombreuses innovations de rupture, qui sont aujourd’hui au cœur de notre économie et de notre quotidien, trouvent leur origine dans des programmes de recherche fondamentale financés par la puissance publique. L’écran tactile de votre smartphone, l’algorithme de Google, le système GPS et de nombreux composants de médicaments essentiels sont les fruits de décennies de recherche publique, notamment militaire et universitaire, que des entreprises privées ont ensuite su développer et commercialiser.
Ce modèle, loin d’être obsolète, est plus pertinent que jamais. Le secteur privé, soumis à la pression des résultats trimestriels, investit massivement dans l’innovation incrémentale (améliorer un produit existant) mais rechigne souvent à financer la recherche fondamentale, dont les retombées sont incertaines et lointaines. C’est ici que l’État-investisseur joue son rôle irremplaçable de capital-risqueur de long terme. En finançant les laboratoires publics et les projets à haut risque, il prépare le terreau des futures révolutions technologiques. D’après son bilan, Bpifrance, en tant qu’opérateur de France 2030, a déployé 5,2 Md€ pour l’innovation auprès de 5 500 entreprises rien qu’en 2024.
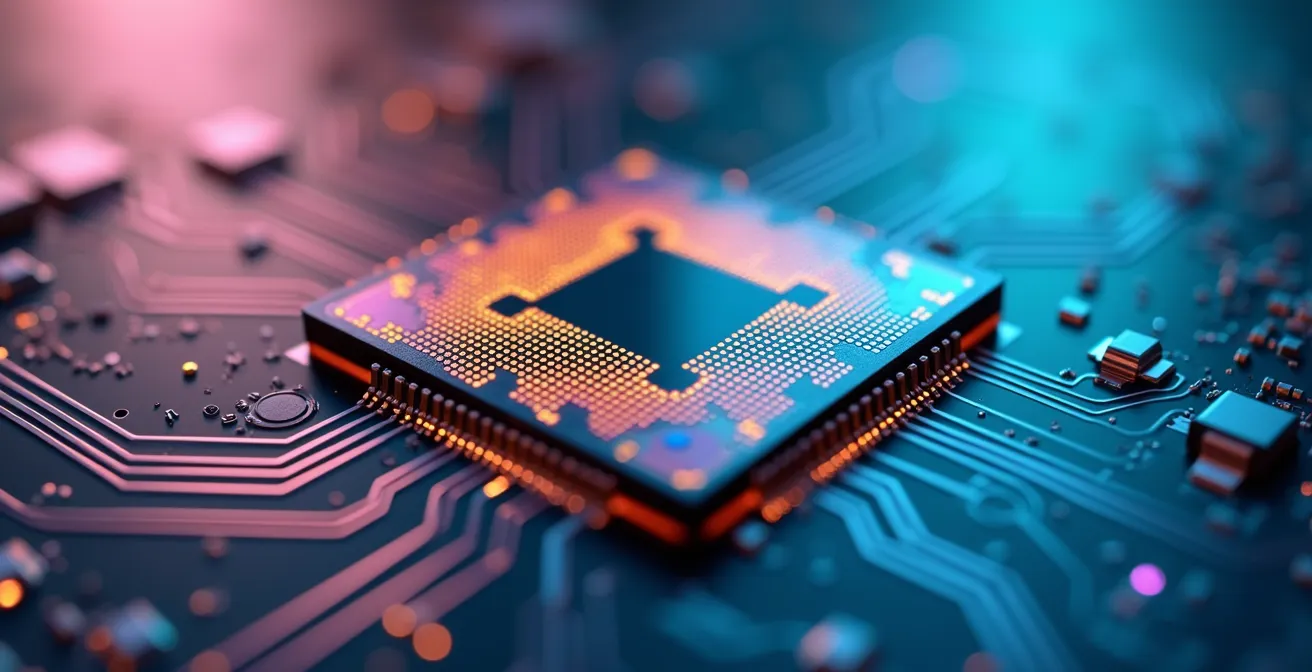
Cette stratégie est au cœur de la vision portée par le gouvernement, comme le résume la mission du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) :
France 2030 mobilise 54 milliards d’euros pour transformer durablement des secteurs clefs de notre économie par l’innovation technologique et l’industrialisation.
– Secrétariat général pour l’investissement, Présentation du SGPI
Loin d’opposer public et privé, ce modèle crée un cercle vertueux : l’État finance la recherche amont et les innovations de rupture, créant de nouvelles opportunités que les entreprises peuvent ensuite saisir pour créer des produits, des services et des emplois. Soutenir le secteur public, ce n’est donc pas freiner l’économie, c’est investir dans son futur moteur.
Y a-t-il vraiment « trop de fonctionnaires » en France ? Ce que disent les comparaisons internationales
Le débat sur le nombre de fonctionnaires et le niveau de la dépense publique en France est souvent passionné mais rarement éclairé par les faits. L’image d’une France championne absolue et isolée de la dépense publique en Europe mérite d’être sérieusement nuancée. Lorsqu’on se concentre non pas sur la dépense totale, mais sur l’investissement public – c’est-à-dire les dépenses qui préparent l’avenir – le tableau est très différent. Cet investissement est crucial, car il finance les infrastructures, les écoles, les hôpitaux et la transition écologique.
En France, une part significative de cet effort repose sur les collectivités. Une analyse de Fipeco montre que 54% de l’investissement public est réalisé par les administrations publiques locales en 2024. Cela signifie que l’investissement se décide et se réalise au plus près des territoires et de leurs besoins spécifiques, loin de l’image d’un État centralisé et jacobin. De 2019 à 2024, le financement public de l’investissement a d’ailleurs augmenté, dépassant son niveau d’avant la crise de 2008, ce qui témoigne d’une prise de conscience de son importance stratégique.
Mais comment la France se situe-t-elle par rapport à ses voisins ? Contrairement aux idées reçues, la France n’est pas une exception délirante. En matière d’investissement public, elle se situe dans une bonne moyenne européenne, comme le montre cette comparaison.
| Pays | Investissement public (% du PIB) | Rang zone euro |
|---|---|---|
| France | 5,5% | 8ème |
| Allemagne | 4,5% | – |
| Italie | 5,0% | – |
| Moyenne zone euro | 4,6% | – |
Ces chiffres montrent que l’effort d’investissement public français, rapporté à la richesse nationale, est non seulement comparable mais même supérieur à celui de l’Allemagne, souvent citée en modèle. Le débat ne devrait donc pas porter sur le « trop » ou le « pas assez » dans l’absolu, mais sur l’efficacité et la pertinence de ces investissements. La question n’est pas de savoir si nous dépensons trop, mais si nous investissons intelligemment pour les défis de demain.
Comment un État fort peut-il être le meilleur rempart contre la « France périphérique » ?
Le concept de « France périphérique » décrit une réalité douloureuse : le sentiment d’abandon d’une partie de la population vivant loin des métropoles dynamiques, là où les services publics (hôpitaux, écoles, bureaux de poste, lignes de train) se sont progressivement raréfiés. Cette fracture territoriale n’est pas une fatalité. Elle est le résultat de décennies de politiques qui, en cherchant à « rationaliser » et à réduire les coûts, ont affaibli le maillage du service public, qui est aussi un maillage social et économique.
Un État-stratège, au contraire, considère la cohésion territoriale non pas comme une charge, mais comme une condition de la prospérité nationale. Garantir un accès équitable aux services essentiels sur tout le territoire est un investissement dans le capital humain et social du pays. C’est permettre à un jeune de se former, à un entrepreneur de créer son activité et à une personne âgée de se soigner, où qu’elle vive. Le déploiement du réseau France Services est une réponse concrète et moderne à cet enjeu. Avec près de 2 800 guichets France services répartis sur tout le territoire, l’État recrée un point de contact physique et humain pour des démarches administratives de plus en plus numérisées.

Ces espaces ne sont pas de simples guichets. Ils sont le visage d’un service public qui se réinvente pour être plus accessible et plus efficace. En regroupant plusieurs administrations (Finances publiques, Assurance Maladie, Pôle Emploi, etc.) en un seul lieu, ils simplifient la vie des citoyens et luttent activement contre la fracture numérique et administrative. C’est la preuve qu’un État fort n’est pas synonyme d’un État lointain et bureaucratique. Au contraire, il peut être le principal acteur d’une proximité retrouvée.
Investir dans les services publics en zone rurale ou dans les quartiers prioritaires, c’est refuser la fatalité d’une France à deux vitesses. C’est un acte politique fort qui réaffirme le principe d’égalité au cœur du pacte républicain et qui, économiquement, permet de libérer le potentiel de tous les territoires.
Comment rendre le service public plus efficace sans le privatiser ? Les pistes pour une réforme de gauche
Défendre un secteur public fort ne signifie pas défendre le statu quo. Le discours de la droite et des libéraux a beau jeu de pointer les rigidités, la lenteur administrative ou le manque d’agilité. L’alternative à une privatisation généralisée n’est pas l’immobilisme, mais une modernisation ambitieuse, pensée non pas pour « réduire les coûts » à tout prix, mais pour améliorer l’efficacité et la qualité du service rendu au citoyen. Une réforme « de gauche » du service public ne vise pas à le démanteler, mais à le rendre plus performant pour mieux remplir ses missions fondamentales.
Les stratégies d’accélération pour l’innovation, pilotées dans le cadre de France 2030, offrent un modèle inspirant. Elles montrent comment l’État peut devenir plus agile et stratégique. La clé réside dans une combinaison d’objectifs clairs, de moyens conséquents et d’un pilotage interministériel efficace. Il s’agit de dépasser les logiques de silos pour mobiliser tous les leviers de l’action publique (financements, normes, recherche, formation) vers des priorités nationales.
Plan d’action pour un service public moderne et stratégique
- Définir des priorités claires : Cibler un nombre limité de secteurs d’avenir (ex: santé, décarbonation, numérique) en concertation avec les acteurs économiques et les partenaires sociaux pour concentrer les investissements.
- Mobiliser tous les leviers : Mettre en place un pilotage interministériel pour aligner les financements, l’évolution des normes, les programmes de recherche et les besoins en formation vers ces objectifs prioritaires.
- Soutenir le cycle complet de l’innovation : Investir massivement de la recherche fondamentale jusqu’à l’industrialisation et le déploiement des solutions, en acceptant le risque inhérent à l’innovation de rupture.
- Évaluer l’impact, pas seulement le coût : Mettre en place des indicateurs pour mesurer l’efficacité des politiques publiques non seulement en termes de dépenses, mais aussi de bénéfices à long terme pour la société (emplois créés, émissions de CO2 évitées, amélioration de la santé publique).
- Investir dans le capital humain : Moderniser la gestion des carrières dans la fonction publique, valoriser l’expertise, développer la formation continue et encourager la mobilité pour attirer et retenir les talents.
Comme le souligne le Secrétariat général pour l’investissement, la stratégie est double : il s’agit de créer un terreau fertile pour l’innovation tout en ciblant des interventions massives. C’est l’antithèse de la logique de « rabot budgétaire » aveugle.
Moderniser le service public, c’est lui donner les moyens de répondre aux attentes légitimes des citoyens en matière de simplicité, de rapidité et de personnalisation, tout en réaffirmant sa mission d’intérêt général que le marché ne peut, par définition, pas remplir.
La France des « laissés-pour-compte » : enquête sur l’impact de la disparition des services publics hors des métropoles
Pour des millions de Français, la « disparition des services publics » n’est pas un concept abstrait, mais une expérience quotidienne. La fermeture d’une trésorerie, d’un guichet de gare ou d’une maternité a des conséquences directes et tangibles : des kilomètres en plus à parcourir, des heures perdues, un sentiment d’isolement et la conviction que la République ne tient pas sa promesse d’égalité. Ce recul de l’État dans les territoires ruraux et les petites villes a nourri une défiance profonde et un sentiment d’être les « laissés-pour-compte » de la mondialisation.
L’impact va bien au-delà du simple désagrément. Pour une personne âgée peu à l’aise avec Internet, la dématérialisation sans accompagnement est une barrière infranchissable. Pour une jeune famille, l’absence de crèche ou d’école à proximité est un frein majeur à l’installation. Le retrait des services publics a un coût économique et social caché : il accélère la désertification de certains territoires, fragilise le tissu social et complique la vie de ceux qui sont déjà les plus vulnérables.
France Services : un bouquet de solutions au plus près des habitants
Le réseau France Services a été conçu pour inverser cette tendance. L’objectif est de ramener le service public au cœur des territoires. Les conseillers formés dans ces espaces ne se contentent pas de fournir un accès à un ordinateur ; ils apportent une aide personnalisée pour des démarches complexes. Ils peuvent aider à déclarer ses revenus, à demander une aide au logement, à préparer son dossier de retraite ou à s’inscrire à Pôle Emploi. En regroupant 12 partenaires nationaux, ces guichets uniques évitent aux usagers de se perdre dans un labyrinthe administratif.
La promesse du réseau est forte : garantir un accès aux services essentiels à moins de 20 minutes de chaque citoyen, en se concentrant sur les zones rurales et les quartiers prioritaires. C’est la reconnaissance que la présence physique de l’État reste, à l’heure du tout-numérique, un pilier de la cohésion nationale et un outil indispensable pour lutter contre le sentiment d’abandon.
Pourquoi le retour de l’entreprise publique est une idée d’avenir pour notre souveraineté
Après des décennies de privatisations présentées comme la solution miracle pour l’efficacité et l’innovation, le concept d’entreprise publique fait un retour en force. Ce n’est pas un retour en arrière, mais une réponse pragmatique aux défis du XXIe siècle. La pandémie de COVID-19 et les tensions géopolitiques ont mis en lumière notre dépendance critique dans des secteurs stratégiques : médicaments, semi-conducteurs, énergie. L’idée que le marché seul, guidé par la recherche du profit à court terme, pourrait garantir notre souveraineté industrielle et technologique a montré ses limites.
L’entreprise à capitaux publics ou l’État-actionnaire redevient un outil stratégique essentiel. Il permet d’orienter l’investissement vers des secteurs jugés vitaux pour la nation, même si leur rentabilité immédiate n’est pas garantie. C’est le cas de la production d’hydrogène décarboné, du développement de nouvelles générations de batteries ou de la construction de « méga-usines » de semi-conducteurs. Bpifrance, par exemple, a injecté près de 60 Md€ dans l’économie française en 2024, agissant comme un catalyseur d’investissement dans des filières d’avenir.

Ce rôle est explicitement revendiqué, notamment à travers des dispositifs ciblés. Comme le souligne Bpifrance dans son bilan d’activité :
L’enveloppe French Tech Souveraineté permet de sécuriser les investissements d’entreprises françaises dans des technologies souveraines, avec trois nouveaux investissements dans McPhy Energy, Phaxiam Therapeutics et The Exploration Company.
– Bpifrance, Bilan d’activité 2024
Le retour de l’État-stratège et investisseur ne signifie pas un rejet du marché, mais une reconnaissance de ses limites. Il s’agit de bâtir un partenariat intelligent où la puissance publique fixe le cap et sécurise les investissements de long terme, et où le secteur privé apporte son agilité et sa capacité d’exécution. C’est en reprenant le contrôle de notre destin industriel et technologique que nous pourrons garantir notre prospérité et notre autonomie futures.
Les points clés à retenir
- L’État-stratège n’est pas un centre de coût mais un investisseur qui prépare l’avenir en finançant les transitions (écologique, numérique) et l’innovation de rupture.
- La recherche publique est à l’origine de nombreuses technologies qui fondent notre économie moderne ; la soutenir est un investissement dans la compétitivité future.
- Un service public fort et bien réparti sur le territoire est le meilleur outil pour garantir la cohésion nationale et lutter contre la fracture entre métropoles et zones rurales.
La garantie des services publics : le socle de notre contrat social
Au terme de cette analyse, une conclusion s’impose : la force d’un État ne se mesure pas à sa capacité à se désengager, mais à sa capacité à investir intelligemment dans l’avenir de sa population et de son économie. Le service public n’est pas une simple collection de prestations administratives ; il est la manifestation concrète du contrat social qui nous lie. C’est la garantie que chaque citoyen, quel que soit son lieu de naissance ou son niveau de revenu, aura accès à l’éducation, à la santé, à la sécurité et à des infrastructures de qualité.
Cet investissement dans le « capital fixe » de la nation est une réalité tangible. Les comptes nationaux montrent que la formation brute de capital fixe des administrations publiques a atteint 126,1 Md€ en 2024, contre 119,7 Md€ en 2023, signe d’un réengagement dans la construction et la modernisation des infrastructures collectives. Défendre et moderniser le secteur public, c’est donc défendre un modèle de société basé sur la solidarité, l’égalité des chances et la vision à long terme.
Plutôt que de céder à la facilité du discours sur la « réduction des dépenses », il est temps de porter un projet ambitieux de transformation. Un projet qui fait de l’État-stratège le pilote de nos grandes transitions, le garant de notre souveraineté et le bâtisseur de la cohésion nationale. C’est cet investissement, et non son affaiblissement, qui constituera notre meilleur atout pour les décennies à venir.
Pour mettre en pratique cette vision, l’étape suivante consiste à exiger un débat public qui ne se focalise plus sur le coût du service public, mais sur la qualité et l’impact de ses investissements pour chaque citoyen et chaque territoire.
Questions fréquentes sur le rôle et l’investissement de l’État
Quelles démarches peut-on réaliser dans une maison France services ?
Vous pouvez y effectuer des démarches liées à votre situation fiscale, votre santé, votre famille, votre retraite ou votre emploi. Les conseillers sont formés pour vous accompagner avec 12 partenaires nationaux comme l’Assurance Maladie, la CAF ou Pôle Emploi.
Comment l’État soutient-il l’innovation des entreprises ?
Via le plan France 2030 et son opérateur principal Bpifrance, l’État a déployé 5,2 Md€ de financement pour l’innovation auprès de 5 500 entreprises. Ce soutien prend la forme de prêts, de subventions et d’investissements en capital pour accompagner les projets depuis la recherche jusqu’à l’industrialisation.
Quelle est la stratégie d’investissement de l’État pour 2025-2029 ?
La stratégie se concentre sur les secteurs d’avenir avec des enveloppes dédiées : 39 Md€ pour l’industrie, 35 Md€ pour le climat et 10 Md€ pour la santé. De plus, un investissement spécifique de 10 Md€ est prévu pour accélérer le développement de l’intelligence artificielle.